Bio-bitumes : demain, nous roulerons sur des routes à base de micro-algues

Bassin de culture de microalgues. Photo AFP
On savait déjà que les micro-algues permettent de fabriquer des biocarburants qui ont pour intérêt de ne pas concurrencer l'industrie alimentaire. La nouveauté, c'est que, pour la première fois, elles ont été utilisées pour faire... du bitume ! Dans une étude publiée ce mois-ci dans la revue "ACS Sustainable Chemistry & Engineering", des chercheurs du CNRS de Nantes, en collaboration avec l'entreprise AlgoSource Technologies, viennent en effet d'apporter la preuve que les caractéristiques du bio-bitume né des micro-algues, sont très proches de celles du « vrai » bitume de nos routes. Une bonne nouvelle pour l'écologie et la planète.
Les infinis trésors des micro-algues
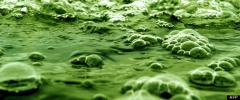 Les micro-algues seraient-elle une vraie réponse miracle aux besoins de l'humanité ? Elles sont connues depuis longtemps pour leurs applications comme colorants en cosmétique ou comme compléments alimentaires. Autre utilisation, les biocarburants. Leur raffinage pour produire des carburants verts, une idée qui a émergé ces dernières années et qu'exploite notamment l'entreprise Fermentalg en Gironde, fait aujourd'hui des micro-algues l'une des alternatives les plus prometteuses au pétrole.
Les micro-algues seraient-elle une vraie réponse miracle aux besoins de l'humanité ? Elles sont connues depuis longtemps pour leurs applications comme colorants en cosmétique ou comme compléments alimentaires. Autre utilisation, les biocarburants. Leur raffinage pour produire des carburants verts, une idée qui a émergé ces dernières années et qu'exploite notamment l'entreprise Fermentalg en Gironde, fait aujourd'hui des micro-algues l'une des alternatives les plus prometteuses au pétrole.
Algoroute
Dans le cadre du programme Algoroute, financé par la région Pays de la Loire, des chercheurs de laboratoires nantais et orléanais ont produit du bio-bitume en valorisant des résidus de micro-algues, issus, par exemple, de l'extraction de protéines hydrosolubles des algues pour l'industrie cosmétique. Pour ce faire, ils ont utilisé un procédé de liquéfaction hydrothermale, de l'eau sous pression, qui transforme ces déchets de micro-algues en une phase visqueuse noire hydrophobe, le bio-bitume, dont l'aspect et les caractéristiques physiques sont très proche de ceux d'un bitume pétrolier.
Retrouvez toutes les vidéos sur la WebTv de l'Université de Nantes
Le faux jumeau du bitume Si la composition chimique du bio-bitume est complétement différente de celle du bitume issu du pétrole, les deux matières ont en effet bien des points communs : leur couleur noire et, surtout, leurs propriétés de déformation et d'écoulement, sous l'effet d'une contrainte appliquée. Liquide au-dessus de 100°C, le bio-bitume peut enrober les agrégats minéraux. Viscoélastique de -20 °C à 60 °C, il assure la cohésion de la structure granulaire, supporte les charges et relaxe les contraintes mécaniques. Bref, des véhicules comme les automobiles, camions, autocars, motos et vélos peuvent rouler dessus. L'importance de l'innovation est de taille pour l'industrie routière, actuellement entièrement dépendante du pétrole, une matière première dont il faut impérativement économiser la ressource. Jusqu'à présent, la fabrication des bio-bitumes utilisait en effet des huiles végétales d'origine agricole qui ont pour inconvénient majeur d'entrer en compétition avec l'alimentation, ou bien issues de l'industrie papetière, mélangées à des résines pour améliorer leurs propriétés viscoélastiques.
Si la composition chimique du bio-bitume est complétement différente de celle du bitume issu du pétrole, les deux matières ont en effet bien des points communs : leur couleur noire et, surtout, leurs propriétés de déformation et d'écoulement, sous l'effet d'une contrainte appliquée. Liquide au-dessus de 100°C, le bio-bitume peut enrober les agrégats minéraux. Viscoélastique de -20 °C à 60 °C, il assure la cohésion de la structure granulaire, supporte les charges et relaxe les contraintes mécaniques. Bref, des véhicules comme les automobiles, camions, autocars, motos et vélos peuvent rouler dessus. L'importance de l'innovation est de taille pour l'industrie routière, actuellement entièrement dépendante du pétrole, une matière première dont il faut impérativement économiser la ressource. Jusqu'à présent, la fabrication des bio-bitumes utilisait en effet des huiles végétales d'origine agricole qui ont pour inconvénient majeur d'entrer en compétition avec l'alimentation, ou bien issues de l'industrie papetière, mélangées à des résines pour améliorer leurs propriétés viscoélastiques.
Solution durable
La culture des micro-algues ne nécessite pas la mobilisation de terres arables. Les utiliser pour fabriquer le bitume de nos routes, est donc une solution durable pour l'avenir de la planète. Maintenant qu'on sait qu'on peut le faire, il faut évaluer la rentabilité du procédé dans la perspective d'une production à grande échelle et étudier la tenue dans le temps de ce nouveau matériau. Ce à quoi s'attèlent dores et déjà les chercheurs, qui ne chôment pas.
Cathy Lafon
►EN SAVOIR PLUS
- Pour lire l'étude : "Subcritical Hydrothermal Liquefaction of Microalgae Residues as a Green Route to Alternative Road Binders", Mariane Audo, Maria Paraschiv, Clémence Queffélec, Isabelle Louvet, Julie Hémez, Franck Fayon, Olivier Lépine, Jack Legrand, Mohand Tazerout, Emmanuel Chailleux, Bruno Bujoli, "ACS Sustainable Chemistry & Engineering", volume 3, issue 4, p. 583–590. cliquer ICI
- Les micro-algues, carburant vert : comment ça marche ?
Les micro-algues représentent une matière première renouvelable et abondante dont la croissance est rapide. Leur culture a besoin de lumière et de CO2 (produit par les industries). Leur récolte est valorisée dans des bio-raffineries d’où sont extraits les bioénergies : le biodiesel, le biométhane, et les bioproduits : des molécules à haute valeur ajoutée et des protéines pour l’alimentation aquacole.
- Le site de Fermentalg en Gironde : cliquer ICI

 L'océan Atlantique est le siège de variations de la température de surface qui s'étendent sur plusieurs décennies et qui influencent le climat de l'Europe. Cette variabilité lente est due à des modifications de la circulation océanique, qui relie les courants de surface aux courants profonds, et qui transporte la chaleur depuis les tropiques jusqu'aux mers de Norvège et du Groenland. Cependant, sa cause reste mal connue. Afin d'en décrypter les mécanismes, les chercheurs ont tout d'abord utilisé des informations couvrant le dernier millénaire et issues d'archives naturelles du climat, obtenues en étudiant la composition chimique de l'eau des carottes de glace du Groenland, mémoire des changements passés de température. Selon ces données, il y a un lien étroit entre la température de surface de l'océan Atlantique et la température de l'air au-dessus du Groenland.
L'océan Atlantique est le siège de variations de la température de surface qui s'étendent sur plusieurs décennies et qui influencent le climat de l'Europe. Cette variabilité lente est due à des modifications de la circulation océanique, qui relie les courants de surface aux courants profonds, et qui transporte la chaleur depuis les tropiques jusqu'aux mers de Norvège et du Groenland. Cependant, sa cause reste mal connue. Afin d'en décrypter les mécanismes, les chercheurs ont tout d'abord utilisé des informations couvrant le dernier millénaire et issues d'archives naturelles du climat, obtenues en étudiant la composition chimique de l'eau des carottes de glace du Groenland, mémoire des changements passés de température. Selon ces données, il y a un lien étroit entre la température de surface de l'océan Atlantique et la température de l'air au-dessus du Groenland.  Pour les scientifiques français, les interférences produites par les trois dernières éruptions volcaniques majeures, Agung en 1963, El Chichon, au Mexique en 1982 et Pinatubo en 1991, expliquent, pour la première fois, la variabilité récente des courants de l'océan Atlantique nord. Les chercheurs en déduisent qu'une éruption majeure dans un futur proche pourrait avoir une incidence pendant plusieurs décennies sur les courants de l'océan Atlantique nord et sur la capacité de prévoir la variabilité du climat européen.
Pour les scientifiques français, les interférences produites par les trois dernières éruptions volcaniques majeures, Agung en 1963, El Chichon, au Mexique en 1982 et Pinatubo en 1991, expliquent, pour la première fois, la variabilité récente des courants de l'océan Atlantique nord. Les chercheurs en déduisent qu'une éruption majeure dans un futur proche pourrait avoir une incidence pendant plusieurs décennies sur les courants de l'océan Atlantique nord et sur la capacité de prévoir la variabilité du climat européen. 
 Trente ans d'inventaire
Trente ans d'inventaire Coordonné par
Coordonné par  Selon le professeur Oliver Phillips (Université de Leeds), coauteur de l’étude et coordonnateur du projet Rainfor sur lequel l’analyse s’appuie, "avec le temps, la stimulation de croissance impacte le système ; les arbres vivent plus vite et meurent plus jeunes." Des sécheresses récentes en Amazonie et des températures anormalement élevées pourraient aussi jouer un rôle important dans le phénomène observé. Si l’étude démontre que l’augmentation de mortalité a commencé bien avant les méga-sécheresse de 2005 ou de 2010, elle montre aussi que ces deux épisodes météorologiques ont causé la mort de millions d’arbres en plus.
Selon le professeur Oliver Phillips (Université de Leeds), coauteur de l’étude et coordonnateur du projet Rainfor sur lequel l’analyse s’appuie, "avec le temps, la stimulation de croissance impacte le système ; les arbres vivent plus vite et meurent plus jeunes." Des sécheresses récentes en Amazonie et des températures anormalement élevées pourraient aussi jouer un rôle important dans le phénomène observé. Si l’étude démontre que l’augmentation de mortalité a commencé bien avant les méga-sécheresse de 2005 ou de 2010, elle montre aussi que ces deux épisodes météorologiques ont causé la mort de millions d’arbres en plus.  Selon l'étude publiée par "Nature", l'accélération de la mortalité des arbres est également liée au déclin de l'intensité du puits de carbone en Amazonie. D’un pic de 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone stockées annuellement dans les années 1990, le stockage net a désormais diminué de moitié. Circonstance aggravante pour l'atmosphère de la Terre, pour la première fois, il est désormais dépassé par les émissions fossiles de l’Amérique du Sud.
Selon l'étude publiée par "Nature", l'accélération de la mortalité des arbres est également liée au déclin de l'intensité du puits de carbone en Amazonie. D’un pic de 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone stockées annuellement dans les années 1990, le stockage net a désormais diminué de moitié. Circonstance aggravante pour l'atmosphère de la Terre, pour la première fois, il est désormais dépassé par les émissions fossiles de l’Amérique du Sud.