
Une voiture électrique présentée au Mondial de l’auto à Paris, le 28 septembre 2012. Photo archives AFP
 Bordeaux attend pour janvier 2014 ses voitures électriques en libre service, les BlueCub. Citiz, le site d'autopartage bordelais, veut en mettre dix en circulation en mai 2014. Sur le web écolo, la polémique enfle: oui ou non, un véhicule électrique est-il réellement plus vertueux pour le climat qu’une voiture à moteur thermique ?
Bordeaux attend pour janvier 2014 ses voitures électriques en libre service, les BlueCub. Citiz, le site d'autopartage bordelais, veut en mettre dix en circulation en mai 2014. Sur le web écolo, la polémique enfle: oui ou non, un véhicule électrique est-il réellement plus vertueux pour le climat qu’une voiture à moteur thermique ?
Réponse : oui, et non, selon une étude de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe), publiée en novembre 2013. Au bout de quelques milliers de kilomètres, elle peut le devenir. Ou pas. Tout dépend l’origine de l’électricité qu’elle utilise.
10 tonnes de CO2 contre 22 pour une voiture diesel, et 27 pour une voiture à essence
La question clé du réchauffement climatique, ce sont les émissions de CO2, principal gaz à effet de serre, qu'il faut absolument parvenir à réduire. En France, par rapport aux moteurs diesel ou thermiques, une voiture électrique présente un avantage indéniable contre le réchauffement climatique, à partir de 50.000 kilomètres au compteur, selon l'étude pilotée par l’Ademe. Certes, sa fabrication, comme celle de toutes les voitures, est une première source de pollution. Mais la voiture électrique qui sort de l’usine a déjà émis plus de CO2 qu'une automobile classique, du fait principalement de l’extraction des métaux qui composent la batterie. Elle rattrape cependant assez vite son retard, en carburant à l'électricité, qui est en France en grande partie d'origine nucléaire, peu ou pas émettrice de gaz à effet de serre. Pour un cycle de vie moyen estimé à 150.000 kilomètres, aux performances techniques actuelles, une voiture électrique émettra au total environ 10 tonnes de CO2, contre 22 pour une voiture diesel et environ 27 pour une voiture à essence, selon le scénario de référence de l’étude.
 Le bémol : le nucléaire a quand même pour inconvénient majeur de générer des déchets radioactifs dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Il représente en outre un énorme danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine, comme nous l'enseignent les catastrophes de Fukushima, au Japon, et de Tchernobyl, en Ukraine. L'idée, en France, c'est de réduire de 50% la part de l'atome dans la production électrique française, d'ici à 2025...
Le bémol : le nucléaire a quand même pour inconvénient majeur de générer des déchets radioactifs dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Il représente en outre un énorme danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine, comme nous l'enseignent les catastrophes de Fukushima, au Japon, et de Tchernobyl, en Ukraine. L'idée, en France, c'est de réduire de 50% la part de l'atome dans la production électrique française, d'ici à 2025...
 Les énergies renouvelables et le cas allemand
Les énergies renouvelables et le cas allemand
« Le bouquet électrique de la phase d’usage a un impact majeur sur le potentiel de changement climatique », observe l'Ademe. En Allemagne, où l’électricité provenait en 2009 à 44% du charbon, très émetteur de CO2, les conclusions sont très différentes. Rechargée outre-Rhin, les émissions de CO2 de la voiture électrique seront plus importantes que celles d'une voiture conventionnelle jusqu’à 100.000 km, équivalente au-delà du 100.000 km et légèrement inférieures (environ 21 tonnes) en fin de vie, à 150.000 kilomètres, selon l'Ademe. La production d'électricité en Allemagne, dépendait encore, en 2009, à 44% du charbon (à 66% d'origine nationale), 2% du pétrole, 13% du gaz naturel (86% importé), 23% du nucléaire (uranium totalement importé) et 18% des énergies renouvelables. Mais d'ici à 2050 , le pays prévoit que les énergies renouvelables aujourd'hui en plein essor, couvriront 80% de la consommation d'électricité et 50% des besoins d'énergies. La donne aura alors considérablement changé.
 Limiter la pollution locale dans les villes
Limiter la pollution locale dans les villes
Pour l'Ademe, la voiture électrique, sans émissions polluantes, « reste indéniablement une bonne arme pour limiter la pollution locale », des villes notamment (photo ci-contre, La Rochelle), souligne Maxime Pasquier, un des responsables de l’étude. De même pour réduire le risque d’épuisement des ressources fossiles. L’expert souligne aussi « l’importance de la phase de fabrication pour le véhicule électrique, qui est liée essentiellement à l’extraction de métaux de fabrication de la batterie ». Certains types de batteries permettent de réduire cet impact « de 20 à 40% », souligne-t-il. L’étude de l'Ademe conclut que l’essor de la voiture électrique ne constitue pas une menace en 2020 pour les métaux et terres rares utilisés dans les batteries, avec des réserves néanmoins pour le cobalt. Reste toutefois un vrai point noir: le risque d’acidification, qui peut contribuer aux pluies acides, lié à l’exploitation du nickel ou du cobalt entrant dans les batteries.
Et les renouvelables ?
C'est drôle, l'Ademe ne met pas clairement en exergue le paramètre de l'électricité quand elle a pour origine les énergies renouvelables. De même, n'est pas évoquée une autre alternative à l'électricité, celle des générateurs HHO qui peuvent produire un gaz qui résulte de l'électrolyse de l'eau, économiseur ou décupleur d'énergie, qui permet de faire rouler les voitures et aussi de se chauffer.
Quant les voitures rouleront au vent...
Quand les voitures rouleront au vent, au soleil ou à l'eau, leur impact sera enfin définitivement moins nocifs pour le climat. D'ici là, réduire ses déplacements en voiture particulière, renoncer au diesel ultra-polluant et adopter le plus possible les transports en commun ou les déplacements doux (à vélo ou à pied), c'est encore la meilleure façon de de lutter contre le réchauffement climatique.
Cathy Lafon
►LIRE AUSSI

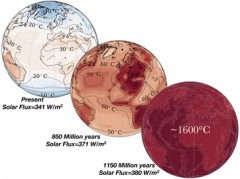 Une étude française
Une étude française
 Bordeaux attend pour janvier 2014 ses voitures électriques en libre service,
Bordeaux attend pour janvier 2014 ses voitures électriques en libre service, Le bémol : le nucléaire a quand même pour inconvénient majeur de générer des déchets radioactifs dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Il représente en outre un énorme danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine, comme nous l'enseignent les catastrophes de Fukushima, au Japon, et de Tchernobyl, en Ukraine. L'idée, en France, c'est de réduire de 50% la part de l'atome dans la production électrique française, d'ici à 2025...
Le bémol : le nucléaire a quand même pour inconvénient majeur de générer des déchets radioactifs dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Il représente en outre un énorme danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine, comme nous l'enseignent les catastrophes de Fukushima, au Japon, et de Tchernobyl, en Ukraine. L'idée, en France, c'est de réduire de 50% la part de l'atome dans la production électrique française, d'ici à 2025... Les énergies renouvelables et le cas allemand
Les énergies renouvelables et le cas allemand Limiter la pollution locale dans les villes
Limiter la pollution locale dans les villes
 Des particules fines, en veux-tu, en voilà
Des particules fines, en veux-tu, en voilà Plusieurs villes de France en alerte, dont Bordeaux
Plusieurs villes de France en alerte, dont Bordeaux Contentieux juridique avec l'Europe
Contentieux juridique avec l'Europe L'Espagne aussi
L'Espagne aussi